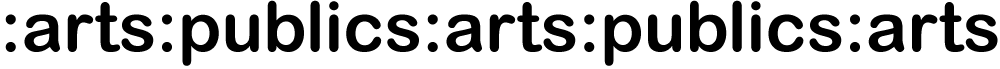Du péril des itinéraires
(PROLEGOMENES PROPITIATOIRES
:Arts :publics : Pour cette revue avant-gardiste et engagée, j’eusse dû produire quelque contenu politique. Or, l’engagement m’est impossible, à cause de l’enracinement de mon individualisme et à cause d’un épisode de ma vie qui m’a fait rompre avec toute possibilité de continuer. La croyance dans la continuité ne conditionne-t-elle pas la foi dans la révolution (politique, artistique) ? Et le plaisir de la communauté n’est-il pas le socle de toute mobilisation ? De fait, je suis individualiste et je n’accorde ni trajectoire ni itinéraire au pluriel.)
Appelez ça don-juanisme existentiel ou ouverture d’esprit ou instinct d’exploratrice ou nomadisme spirituel ou hyperactivité ou hygiène. Il m’est désormais impossible de retourner une seconde fois sur un chemin déjà parcouru, une personne déjà rencontrée, un café où je me suis déjà assise, un livre que j’ai déjà lu.
Moi, qui adulais les routines ! Moi, ancien être de pèlerinages et de fidélités ! Moi, pour qui revenir sur les traces de moi-même, retrouver mon sillon, sentir, comme le chat parmi son territoire, mes vestiges olfactifs, faisait le bonheur !
Je n’allais jamais nulle part (puisqu’il y a des endroits partout). J’aimais les vieilles routes et dans mon sentimentalisme, j’empruntais sans cesse les mêmes itinéraires.
Je partais courir chaque jour le long de la Seine qui s’allongeait presque au bas de l’immeuble où je coulais des jours réguliers. Un matin de juillet, je croisai l’homme, assis, de dos, au bout des quais, quand ils font un coude et disparaissent dans le bras étroit d’une écluse. Il avait une veste de peau lainée dont on devinait – dans l’explosion d’odeurs estivales, sauterelles écrasées, sécrétions génitales des oiseaux, sèves sucrées, soleils cuisants, haleines des chiens en promenade dont la gueule ouverte exhalait des infections sous la canicule – l’âcre saveur de mouton. Rapidement, car il m’effraya, je traversai la zone en frôlant la levée de pierres et montai pour regagner le trottoir des bouquinistes. Dans les escaliers, je faillis prendre de face, à l’instant où je me tournai pour observer si l’on me regardait, une femme qui courait elle-aussi dans la descente. Je partis en vacances le lendemain et n’y songeais plus jusqu’à mon retour dans la capitale.
De nouveau, je vins m’aérer le long de la Seine. De nouveau, l’homme en peau de mouton, demi-allongé dans l’attitude d’une Madame Récamier sur sa chauffeuse, mais vue de dos. Il regardait l’eau. A mon passage, il se tourna légèrement. Une femme passa entre nous et fit diversion. Je poursuivis ma route.
Le lendemain, cela se reproduisit : il faut me comprendre, j’aimais faire la même chose chaque jour, j’y trouvais un équilibre profond qui me permettait de supporter les haïssables perturbations du quotidien. L’homme, de même, se retourna et une femme passa. Peut-être était-ce la même, les gens ont leurs horaires et les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Rien ne s’était passé, donc : je n’y pensais plus et considérai cet échange de regards d’une seconde comme établi et fixé dans mon rituel. Mais lui (peut on savoir ? supputer, seulement supputer), chaque jour, par incrément, brisait la frontière de l’inconnu qui nous prend toujours de court et rapetissait l’écart qui sépare la perception de l’action. Le « trop tard » qu’il se disait vaguement en me croisant mettait toujours plus de temps à arriver et ce décalage ouvrait, petit à petit, l’espace de l’agir. Moi, courant la même durée, le même itinéraire, sautant presque sur les mêmes pavés, croisant une femme au même endroit, je ne voyais que le renouvellement du même.
Je m’habituais. Il m’aurait manqué, même, s’il n’avait pas été exactement là, chaque jour, de dos, à contempler la Seine, demi-allongé, sur la pause méridienne. Sa peau de mouton, l’automne s’avançant, perdait de sa bizarrerie. Il faisait un peu frais. Il devait dormir dehors. Je savais, par expérience, le temps que l’on prend à se réchauffer quand on a vraiment creusé ses réserves de chaleur. La nuit devait être dure. Dans le soleil clair, il reprenait force et engrangeait les rayonnements qu’il devait se redistribuer dans le froid et l’obscurité que je ne voyais jamais. Je lui donnai raison.
Je reçus deux avertissements pourtant et je ne changeai rien. Je ne peux pas me plaindre de la vie.
Le premier jour de novembre, la femme me sourit.
Le deuxième jour de novembre, mon regard, porté avec confiance vers le dos carré de l’homme abimé dans ses méditations fluviales, chut d’étonnement, comme quand on croit saisir un objet lourd et que notre main trompée retombe d’un coup, surprise par sa force inutile. L’homme n’était pas là. Il y avait le vélo durci, hors d’usage, qui lui servait de suspensoir à objets divers, il y avait les menues choses d’un campement de fortune disposées çà et là. Il y avait encore la coureuse, venant en sens inverse : elle me sembla froncer imperceptiblement les sourcils et ne me regarda pas.
Le troisième jour, cela se passa en un éclair. La femme arrivait en trottinant. Lui, il jaillit trois mètres devant moi, vecteur de couleurs et d’odeurs plutôt que perception claire, les deux mains en avant. Il y eut un bruit mat, sourd, mort puis un éclat clair, vif, joyeux. Je n’ai pas compris ce qui s’était passé mais je garde l’image hyper réaliste, vue ou imaginée, d’un pied butant contre la pierre inégale du pavé et, une seconde plus tard, du genou heurtant la marche immergée du rebord et glissant ensuite sur la chevelure maigre des algues nauséabondes qui naissent dans ces eaux polluées et qui ondulent au gré des courants d’eau. Comment dire ? La chute avait été irrégulière. Même pas propre. Le corps devait être singulièrement distordu, après cette trajectoire heurtée.
Et moi ? J’ai poursuivi ma course régulière, à peine plus rapidement.
Alors, rien ? Si, depuis, j’ai rompu avec mon itinéraire.